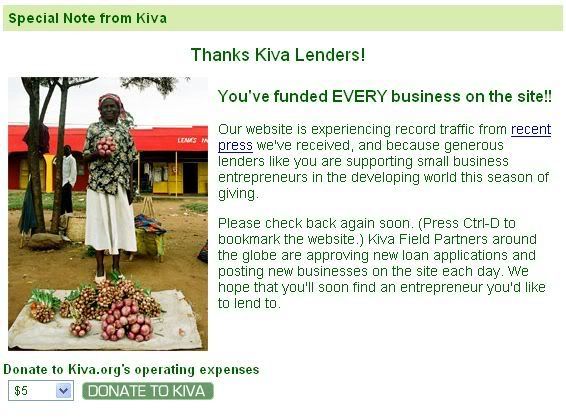31/12/2007
Le professionnalisme en médecine.
J’ai enfin lu l’article auquel se référait l’éditorial dont j’ai déjà parlé ici.
Les résultats sont sujets à de nombreuses interprétations, vous allez pouvoir le constater.
Là aussi, comme pour l’éditorial, l’article décrit une réalité américaine, donc méfiance pour en tirer des conclusions hâtives sur nos pratique européennes.
Tout d’abord, l’étude s’appuie sur une Charte pour les praticiens, publiée en 2002 et dont je n’avais jamais entendu parler (version française disponible ici).
Cette charte comporte 3 principes fondamentaux :
- Principe de la primauté du bien-être des patients.
- Principe de l’autonomie des patients.
- Principe de la justice sociale.
Et 10 responsabilités professionnelles :
- Engagement envers la compétence professionnelle.
- Engagement vers l’honnêteté à l’égard des patients.
- Engagement vers la confidentialité des patients.
- Engagement envers l’entretien de rapports « convenants » (convenables, plutôt…) avec les patients.
- Engagement envers l’amélioration de la qualité des soins.
- Engagement envers l’amélioration de l’accès aux soins.
- Engagement envers la juste répartition de ressources limitées.
- Engagement envers la connaissance scientifique.
- Engagement envers le maintien de la confiance par le gestion des conflits d’intérêts.
- Engagement envers les responsabilités professionnelles.
Les auteurs ont envoyé un questionnaire à 3504 médecins inscrits à l’American Medical Association (j’imagine que cela correspond à notre « tableau ») afin de savoir si ils adhéraient à ces principes et responsabilités et si ils les appliquaient dans leur pratique courante.
Par ailleurs, chaque questionnaire était accompagné d’un chèque de $US20.
Voici les résultats.
En général, une grande majorité des 1662 médecins qui ont répondu (sur les 3167 éligibles) adhèrent à ces principes.
Par exemple :
- 98% déclarent vouloir diminuer les disparités des soins en relation avec la race ou le sexe.
- 93% déclarent vouloir fournir des soins nécessaires, sans avoir à tenir compte des possibilités des patients à les payer.
- 77% pensent que les praticiens doivent faire réévaluer leurs connaissances tout au long de leur carrière.
- 96% déclarent qu’il faut placer le bien-être du patient au dessus de leur propre intérêt financier.
- 96% pensent qu’il faut dénoncer un collègue incompétent, et 93% une erreur médicale aux autorités.
- 85% déclarent qu’il faut être honnête avec les patients, et leur signaler (ou à leurs proches) toute erreur médicale.
Aucun point recueille moins de 77% d’approbation.
Maintenant, en pratique, les choses sont un peu différentes:
- 36% vont prescrire une IRM qu’ils savent être inutile pour « satisfaire » un patient insistant.
- 25% ont vérifié qu’il n’existait pas de différence de prise en charge dans leur pratique (ou celle de la structure où ils travaillent) au cours des 3 dernières années.
- Moins de 1% ont menti et 3% ont caché une information à leurs patients (ou aux proches) au cours des trois dernières années.
- 69% acceptent de soigner des patients non assurés, et ne pouvant pas payer.
- 74% ont donné en connaissance de cause des soins gratuitement au cours des 3 années précédentes.
- 11% ont brisé le secret médical au cours des 3 années précédentes.
- 24% adresseraient un patient à un centre de radiologie dans lequel ils auraient des parts.
- 45% ne dénoncent pas systématiquement un collègue dangereux, 46% ne déclarent pas une erreur médicale grave pourtant portée à leur connaissance aux autorités.
Je n’ai pas reporté tous les résultats, j’ai choisi ceux qui me semblaient intéressants.
Parce que je suis particulièrement modeste, je ne vous préciserai pas non plus que ce sont souvent les cardiologues (ainsi que les chirurgiens et les anesthésistes, soyons honnêtes) qui ont la conduite la plus « exemplaire ».
;-)
On peut d’ores et déjà direqu’il existe dans certains cas une grande disparité entre ce que les médecins pensent être bien, et ce qu’ils font en réalité.
En lisant les réactions médicales et non médicales dans la presse américaine, je n’y ai souvent lu que de la gène (de la part des médecins), ou de la réprobation mesurée (et diplomatique) de la part des autres (voir aussi ici).
Ce n’est pas très étonnant. Nous sommes des êtres humains, donc ni meilleurs, ni pires. L’attente sociale est importante, et elle me semble méconnaître ce point pourtant fondamental.
Pour ma part, je ne suis ni gêné ni surpris de ces résultats.
La seule chose qui me chiffonne le plus est la faible part des médecins qui dénoncent un collègue ou une erreur médicale. Je suis intimement persuadé qu’en France, ces chiffres sont bien plus faibles. Le poids du Conseil de l’Ordre et de la « confraternité » sont probablement bien plus importants chez nous.
Si je sais qu’un confrère est dangereux, je ne vais pas le dénoncer au Conseil ou aux autorités de tutelle, mais je vais tout faire pour que les patients en face de moi n’aillent plus/pas le voir. Un jour, il y a peu de temps d’ailleurs, j’ai conseillé à un patient de porter plainte. Je ne suis jamais allé au-delà. Je ne connais personnellement aucun médecin qui n’ait pas cette attitude.
Je suis persuadé que ce ne sont pas ces « manquements » finalement minoritaires qui vont conduire à notre perte (si elle doit survenir, soyons un peu optimistes). Par contre, les attentes du public croissent à mon avis de manière tout à fait alarmante et en disproportion de tout ce qui est raisonnable.
Vous allez dire que c’est facile pour moi de me décharger et de dire que ce sont les patients qui sont déraisonnables.
Toutefois, le public a été habitué aux avancées techniques fabuleuses de ces dernières années, probablement en grande partie aussi à cause de médecins trop confiants et trop farauds devant des médias avides de sensationnels.
Maintenant, il devient de plus en plus difficile d’« avouer » (à dessein, je n’emploie pas le verbe « dire ») à un patient ou à une famille, que l’on ne peut rien, ou que l’on a rien vu venir.
Maintenant, il est impossible de revenir en arrière.
Les médecins sont confrontés à une demande de performance qui est par nature impossible à satisfaire.
L’Homme est destiné à mourir et à souffrir de maladies et de traumatismes.
C’est ainsi, et dans une grande mesure, on n’y peut rien.
Jusqu’à présent, les médecins faisaient ce qu’ils pouvaient pour retarder et améliorer l’échéance.
Mais à l’évidence, cela ne suffit plus.
De mon point de vue, par nature partial et partiel, les médecins ne sont ni meilleurs ni pires qu’il y a 2300 ans, par contre les attentes du public ne sont plus du tout les mêmes. La fatalité est devenue échec, et l’échec rend coupable.
Qu’est ce qui me fait dire, à moi 36 ans l’an prochain que mes confrères étaient les mêmes qu’il y à 2300 ans ?
Je n’y était pas, mais si Hippocrate, (ou quelqu’un d’autre qui lui a laissé la paternité) a eu l’idée de rédiger un code de bonne conduite, c’est que le besoin s’en faisait ardemment sentir.
On ne régule pas ce qui se fait bien naturellement.
Nous allons donc rentrer dans une époque de régulations, de certifications dont l’épaisseur de chaque feuille de papier supplémentaire va nous séparer un peu plus du patient et de l’essence de notre métier. Je ne suis pas contre une régulation raisonnable, une actualisation de nos principes fondamentaux. Mais peut-être qu'il faudrait déjà les transmettre et les expliquer un peu plus et un peu mieux à tous les médecins (les "en devenir" et les autres). Trop de régulation tue la régulation (c'est un beau cliché), d'autant plus si elle est dictée sous la pression d'une évolution des mentalités qui me semble déraisonnable. Cet article en est la preuve éclatante.
Cette étude ne m’étonne pas, donc, ni le fait que l’on ait pensé à la faire, ni les résultats, ni les nombreux commentaires.
Elle est parfaitement dans l’air du temps.
°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°
Project of the ABIM Foundation, ACP–ASIM Foundation, and European Federation of Internal Medicine. Medical Professionalism in the New Millennium: A Physician Charter. Ann Intern Med 2002. 136 (3): 243.
Campbell EG, Regan S, Gruen RL, Ferris TG, Rao SR, Cleary PD, Blumenthal D. Professionalism in Medicine: Results of a National Survey of Physicians. Ann Intern Med. 2007;147:795-802.
13:20 Publié dans Prescrire en conscience | Lien permanent | Commentaires (1)
30/12/2007
Les passeurs.
J’ai finalement terminé « Le livre des passeurs » de Armand et Eliette Abécassis (Ed. Robert Laffont).
Ce bouquin collecte des extraits d’œuvres qui ont jalonné 3000 ans de littérature juive ; « De la Bible à Philip Roth », comme le dit le sous-titre.
Je ne suis pas en mesure de commenter le choix des textes, mais ils me semblent remarquablement cohérents dans l’objectif de ce recueil qui est d’expliquer les pérégrinations de l’âme juive depuis 3000 ans.
Mes seuls bémols : je suis toujours un peu gêné par le caviardage du texte de Maimonide, et j’avoue avoir survolé de très très haut quelques textes de Rabbins exégétiques du Xème siècle.
Mais bon, je pars de loin aussi. Je crois l’avoir déjà dit, mais le seul cours duquel je me sois fait chasser un jour était un cours de catéchisme obligatoire avant ma première communion.
Les commentaires des auteurs sont heureusement là pour palier à mon ignorance crasse.
Les textes contemporains sont bien plus accessibles et assez inattendus pour certains auteurs.
J’ai complété ma liste sans cesse en mouvement des « livres à acheter ».
Notamment, j’ai envie de connaître Philip Roth (si vous avez des conseils, n’hésitez pas).
Mais ce qui m’a le plus fait réfléchir, c’est le terme même de « passeur ».
Chaque génération « passe » son savoir, sa culture à la suivante.
Chez les juifs, il me semble que la religion et le mode de vie sont liés, plus ou moins, mais ils le sont indubitablement. D’où l’importance de la transmission.
Mais chez nous, et notamment chez moi ?
Je suis athée, quasiment militant puisque j’ai rompu la tradition familiale probablement immémoriale en ne faisant pas baptiser mes enfants. Je trouvais préférable de leur laisser le choix de rentrer dans « la communauté des croyants » plus tard, lorsqu’ils seront en âge de comprendre.
Bon, si ils ont la malchance de tomber amoureux d’une fille adepte du « jamais avant le mariage », ils vont me haïr en ruminant leurs frustrations sur les bancs de la cure non chauffée du village, sous la houlette vigilante d’un brave curé couperosé.
Pour ma part, je n’ai jamais pensé à l’apostasie. Mes convictions athéistes ne vont pas jusque là.
Ne pas donner d’éducation catholique à mes enfants ne me gène donc pas pour son côté religieux. Par contre, nous vivons dans une société judéo-chrétienne et la culture, l’art, et les livres qui se parlent les uns aux autres, comme le dit si joliment Umberto Ecco font presque toujours référence au « Livre ». A tel point que la majuscule nous indique tout de suite de quel livre nous parlons.
Comment comprendre un Rembrandt, ou d’innombrables expressions comme « pauvre comme Job », ou « colosse aux pieds d’argile » sans connaître un minimum d’Histoire Sainte ?
Je la connais un minimum, car je ne me suis pas fait virer tous les jours du cours de cathé, et aussi car j’ai connu Caroline bien plus tard.
Mais mes enfants ?
Avec Sally (qui est aussi athée que moi), on a envisagé d’acheter une Bible illustrée. Ô ironie ! Je vais me retrouver à leur faire la lecture des évangiles chaque soir, comme dans n’importe quelle famille catholique pratiquante. Vision d’horreur à laquelle je ne me résous pas.
Heureusement, ils n’ont encore que 4 ans et 5 ans et demi.
J’ai encore quelques années pour résoudre la quadrature du cercle.
20:34 Publié dans ma vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (4)
29/12/2007
Un présage favorable pour 2008 ?!
12:50 Publié dans Kiva | Lien permanent | Commentaires (0)